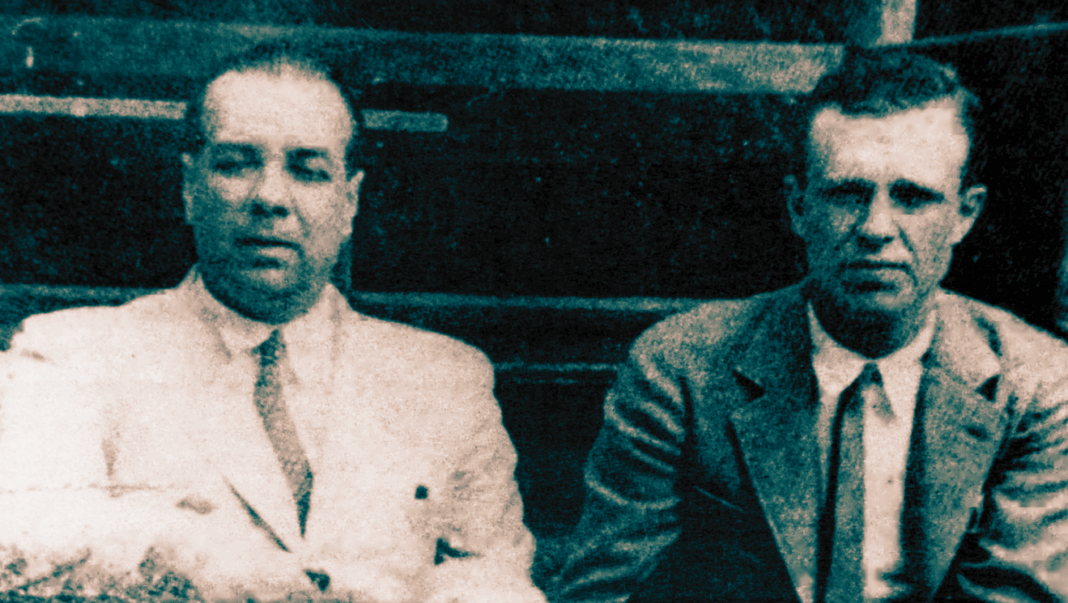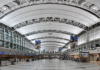L’amitié entre Jorge Luis Borges, un Argentin extraordinaire, et Adolfo Bioy Casares, qui l’a relatée avec dévotion et obsession, est un cas exotique d’un phénomène typiquement argentin.
L’Argentine a été inventée par un groupe de commerçants portègnes adeptes de la contrebande. La mythologie du pays naissant s’est fondée sur l’étendue plate de la Pampa, le désert vert. Son épopée en vers fut le chant de Martín Fierro, avec pour protagoniste non pas un noble héros aristocratique, mais un hors-la-loi qui s’enfuit vers la frontière, vers la Pampa, pour échapper aux griffes armées de l’État.
De ces mythologies encore jeunes est né, cent cinquante ou deux cents ans plus tard, un lieu commun argentin : celui de l’informalité, qu’elle soit fiscale ou relationnelle. La véritable économie fonctionne en dehors de l’économie officielle, et le soutien ne vient pas des institutions organisées mais d’institutions moins organiques, comme les clubs sportifs ou d’autres associations d’affinités électives. L’institution inorganique par excellence, celle qui manque à ceux qui se débrouillent à l’étranger, est celle de l’amitié, pratiquée à travers deux exercices gastronomiques : celui du maté et celui de l’asado.
Chez les « Bioy »
En marge de l’État volontariste, en marge de la page et en marge de la culture occidentale, Jorge Luis Borges, un Argentin exotique, de lignée criolla, élevé par hasard ou par confusion paternelle délibérée dans l’Europe de la Grande Guerre et des avant-gardes artistiques, est devenu inopinément bien plus que le plus grand écrivain argentin. Lorsqu’il a accosté à Buenos Aires à l’âge de vingt ans, il s’est senti étranger à cette ville envahie par les Italiens, qui déformaient même la façon argentine de parler, et peu à peu il a commencé à concevoir sa vengeance : celle d’écrire des contes créoles et universels dans une langue unique, ancienne, qui semblerait éternelle mais aussi intime, impersonnelle mais personnelle. Il a commencé à déguiser ses textes avec les dernières nouveautés et des encyclopédismes, des pièges faussement érudits pour cacher au lecteur un homme sentimental, simple, capable de comprendre et de trouver les meilleurs mots pour les grandes expériences humaines : celle de Dieu (« divin labyrinthe des effets et des causes »), l’amour (« qui nous permet de voir les autres comme la divinité les voit ») ou l’amitié.
Borges a pratiqué l’amitié avec de nombreux hommes et femmes, parmi lesquels se distingue Adolfo Bioy Casares. En 1936, Borges a inclus dans un livre d’essais une critique d’un livre fictif, « The Approach to Al-Mu’tasim », d’un supposé avocat anglo-hindou. Adolfo Bioy Casares, un jeune homme de vingt et un ans, qui avait prématurément publié plusieurs livres avec l’argent de son père, est tombé dans le piège de Borges et a commandé le livre hindou inexistant à sa librairie de Londres. Ce malentendu a créé l’une des amitiés les plus durables et prolifiques du XXe siècle argentin.
Bioy s’est marié peu après avec une femme un peu plus âgée que lui, peut-être l’autre grande écrivaine argentine du XXe siècle après Borges : Silvina Ocampo. Pendant près de cinquante ans, Borges est allé plusieurs soirs par semaine dîner chez « les Bioy », poussé par le sentiment d’amitié, par le goût de la conversation interminable et peut-être par le désir de Georgie de fuir l’appartement qu’il a partagé avec sa mère jusqu’à la mort de celle-ci, alors que Borges avait déjà 76 ans.
Après l’écriture conjointe d’une brochure pour l’entreprise laitière de la famille maternelle de Bioy, l’un des premiers témoignages littéraires de cette amitié intime est la préface de Borges au premier roman de Bioy, L’Invention de Morel. Le roman, auquel il ne consacre qu’un seul des 795 mots que compte la préface (ce mot est « parfait », mais nous n’avons pas à croire Borges), est en réalité un prétexte pour Borges d’écrire le programme de la littérature à venir : les romans du réalisme magique, l’œuvre de Cortázar, García Márquez et Carlos Fuentes, découlent de cette préface. Le dédain de Borges envers son jeune ami relève d’une pédagogie par l’intimidation, une insulte stimulante du genre de celle que son personnage, le coupe-jarret Rosendo Juárez, adresse à son jeune disciple (l’assassin et narrateur du conte) dans « “Hombre de la esquina rosada ». L’éducation, pour Borges, était aussi provocation.
Contes à quatre mains
Durant ces années, Borges et Bioy ont collaboré à l’écriture de contes dans lesquels Borges s’est permis une attitude plus ordinaire, qu’il ne s’autorisait pas dans son œuvre officielle. Ils ont signé leurs contes à quatre mains avec des pseudonymes mêlant leurs noms à la généalogie criolla : Honorio Bustos Domecq et Benito Suárez Lynch.
Deux des artefacts narratifs les plus complexes écrits par Borges durant sa période créative des années quarante, « Tlön Uqbar Orbis Tertius » et « L’Immortel », rendent hommage à cette amitié avec Bioy, qui fut comme son atelier littéraire, le lieu où il confrontait ses idées et où germaient ses œuvres. « Tlön… » est en réalité, outre l’invention d’une planète invraisemblable, la narration d’une scène où Bioy et Borges lisent et commentent un article d’encyclopédie. L’amitié entre eux, un miroir en soi, a à son tour un autre miroir, qui est l’amitié du père de Borges avec un Anglais : « Mon père avait noué avec lui (le verbe est excessif) une de ces amitiés anglaises qui commencent par exclure la confidence et qui très vite omettent le dialogue. Ils pratiquaient un échange de livres et de journaux ; ils jouaient tacitement aux échecs… ». Borges se permet aussi dans le conte une blague géniale sur ses propres traumatismes liés à l’intimité sexuelle. « La copulation et les miroirs, fait-il dire au personnage de Bioy, sont abominables, parce qu’ils multiplient le nombre d’hommes ». C’est une ironie que les années ont rendue évidente : on sait que la collection d’amantes du beau Bioy se comptait par centaines, tandis que Borges n’a probablement jamais eu de rapport complet avec une femme : l’amitié entre Bioy et Borges était celle qui liait un copulateur en série et un ascète, quelqu’un qui n’a peut-être jamais connu bibliquement une femme. Borges se riait de ses propres misères.
Dans « L’Immortel », qui dure des siècles, un légionnaire romain se lie d’amitié avec un troglodyte qui s’avère être Homère. Ayant acquis l’immortalité (littérale et métaphorique) après avoir bu l’eau d’une rivière, Homère et le légionnaire se quittent sans se dire adieu (encore une fois l’amitié silencieuse, anglaise), confiants qu’ils se reverront. Mais le légionnaire retrouve sa mortalité en buvant une autre eau, et ils ne se revoient jamais. À la fin, le légionnaire dit : « Quand la fin approche, il ne reste plus d’images du souvenir ; il ne reste que des mots. Il n’est pas étrange que le temps ait confondu celles qui m’ont représenté un jour avec celles qui furent les symboles du destin de celui qui m’a accompagné pendant tant de siècles. J’ai été Homère ; bientôt, je serai Personne, comme Ulysse ; bientôt, je serai tous : je serai mort. » C’est pour moi une certaine idée (définition) de l’amitié, en particulier de celle qui le lie à Bioy, à savoir une confusion d’identité avec l’autre.
Ce conte, écrit en 1948, revêtit, comme tant d’autres textes de Borges, un esprit prophétique, puisqu’en effet Borges et Bioy se sont quittés sans se dire adieu en personne, María Kodama l’ayant emmené en 1986 mourir à Genève.
Bioy sentait que Kodama, secrétaire puis épouse de Borges après la mort de la mère de celui-ci, avait éloigné Borges de ses amis et le faisait souffrir. La rivalité entre Bioy et Kodama fut durable : jusqu’à peu avant sa mort en 2023, sa veuve racontait qu’une fois, après que Bioy eut publié un de ses romans, Borges lui avait dit : « Quand Adolfito se rendra-t-il compte qu’il ne sait pas écrire ? » Cette malice eut peut-être pour origine la grande surprise posthume que donna l’œuvre de Borges, qui fut le Borges de Bioy Casares, un livre de plus de 1500 pages qui compile avec dévotion chacune des conversations qu’eurent les amis au cours de plus de quarante ans. « Borges dîne à la maison », commence chaque entrée, utilisant un verbe qui dénote l’appartenance sociale : la classe moyenne dit « souper », tandis que seule la classe supérieure d’origine agricole dit « dîner ». Avec un amour d’adepte, de fan et d’ami, Bioy enregistre l’oralité d’un Borges pétillant et intime, aussi génial pour les commérages que pour les lectures littéraires. C’est sûrement le témoignage le plus abondant de l’histoire sur une amitié, comparable à celui de Platon sur Socrate. Le livre est précédé d’une épigraphe en français de Silvina Ocampo qui parle avec éloquence de la considération et de l’affection qu’elle et Adolfo avaient pour Borges : « Dîner avec Borges est une des coutumes les plus douces de ma vie. Elle me permet de croire que je connais Borges plus que mes autres amis, parce que l’heure du dîner est avant tout l’heure de la conversation. »
Promenades à BA et voyages à travers le monde. Sur les traces de Borges et Proust.
Un samedi de 2021, la flâneuse Catalina Lascano m’a dit qu’elle allait m’emmener à un angle de rue à Floresta, qui était peut-être le même que Borges avait contemplé une nuit de 1926 ou 1927 après une longue promenade, qui a trouvé sa place dans « Se sentir dans la mort », l’un des textes qui aboutissent à « “Hombre de la esquina rosada », où l’angle de rue en question est le lieu secret et équivoque du narrateur. Nous avons marché jusqu’à ce passage à Boeri et Trieste et quelque chose s’est illuminé en nous, comme chez Borges près d’un siècle auparavant. Borges était accro à Buenos Aires, et l’a parcourue avec délectation. Avec Catalina, nous avons commencé à organiser des promenades basées sur les itinéraires de Borges, généralement loin des lieux touristiques : nous avons ainsi parcouru Saavedra, Villa Ortúzar ou Floresta.
Durant ces années, j’ai également donné trois cours annuels sur À la recherche du temps perdu, le roman magnifique de Marcel Proust. À la demande des élèves, Catalina et moi-même avons organisé un voyage de fin d’études, basé sur un itinéraire à travers Paris, la vallée de la Loire et la Normandie en utilisant comme guide le texte de Proust ainsi que ceux d’autres auteurs comme Baudelaire, Flaubert et Marie d’Agoult. En 2024, en plus de suivre les pas de Proust et consort à Paris, nous avons suivi ceux des beatniks et des écrivains du noir en Californie, et en 2025 nous suivrons ceux de Platon, Pasolini, Camilleri (et aussi Borges) en Sicile, ceux de la mythologie nordique (dont le gardien est encore Borges) et de la littérature nordique contemporaine en Norvège et en Islande, et nous allons bientôt recommencer les voyages en France.